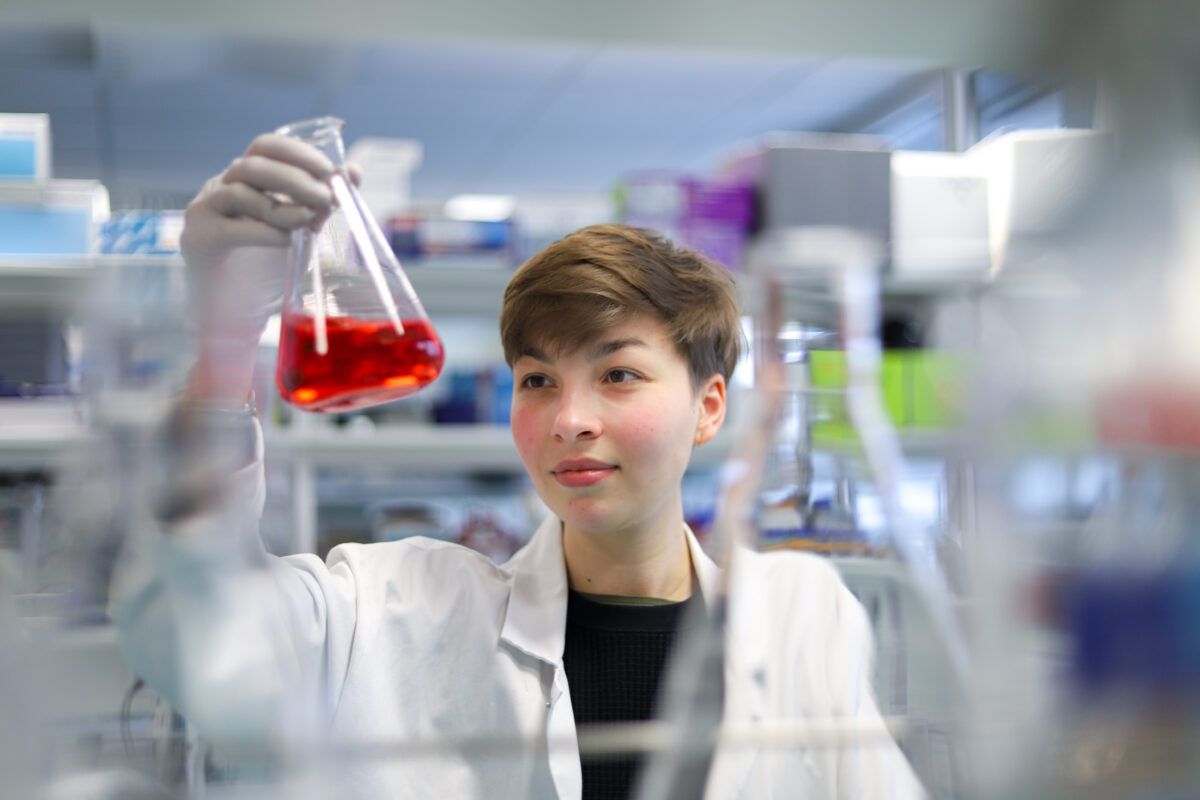![]() Soutenance en français
Soutenance en français
Equipe : REMEMBeR (Mécanismes Neurobiologiques de la Mémoire – CRCA-CBI
Encadrement : Cédrick FLORIAN (CRCA-CBI) et Claire RAMPON (CRCA-CBI)
Jury :
- Anne-Laurence BOUTILLIER – Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA), Strasbourg
- Cyrille VAILLEND – Institut des Neurosciences Paris-Saclay (NeuroPsi), Paris
- Jean-Louis GUILLOU – Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (INCIA), Bordeaux
- Shauna PARKES – Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (INCIA), Bordeaux
- Guillaume ISABEL – Centre de Recherches sur le Cognition Animale (CRCA-CBI), Toulouse
Résumé:
La mémoire à long terme se forme au cours d’un processus de consolidation nécessitant une transcription de novo de gènes, régulée par des mécanismes épigénétiques. Les modifications épigénétiques, incluant les acétylations des histones qui structurent la chromatine, sont ajoutées ou retirées respectivement par des histones acétyltranférases (HATs) et des histones deacétylases (HDACs). Ces dernières sont recrutées aux gènes cibles par des complexes répresseurs transcriptionnels. Bien qu’encore peu étudiés, la littérature montre l’engagement de ces complexes répresseurs dans la formation de différents types de mémoire, mettant ainsi en exergue la question d’une implication importante de ces derniers dans les processus mnésiques. Ainsi, nous avons choisi d’étudier l’un de ces complexes, SIN3A-HDACs, dans le cadre de la consolidation d’une mémoire dépendante de l’hippocampe. En outre, un grand nombre d’études ont examiné la fonction des HDACs, en particulier les HDACs 1 et 2, dans les processus de la mémoire en utilisant des modèles de souris génétiquement modifiés pour ces enzymes. Cependant, leur rôle dans la phase de consolidation de la mémoire ne peut être mis en évidence que par leur inhibition ponctuelle comme par l’administration d’inhibiteurs pharmacologiques des HDACs. Ainsi, pour tester notre hypothèse selon laquelle le complexe SIN3A- HDACs participe à la formation de la mémoire à long terme, nous avons ciblé spécifiquement les deux entités de ce complexe en tentant d’établir un modèle murin déplété en SIN3A ou en inhibant spécifiquement les HDACs 1 et 2 par l’administration du composé 60 (Cpd-60) dans l’hippocampe dorsal. Les premiers résultats de ce travail de thèse ont montré un rôle de la protéine SIN3A, mais aucun effet du Cpd-60 sur la consolidation de la mémoire contextuelle générée en soumettant des souris adultes à un conditionnement de peur. La première partie de ce manuscrit présente les différentes approches que nous avons utilisées pour cibler SIN3A et les effets d’une injection de Cpd-60 au niveau moléculaire et comportemental. La seconde partie de ce travail de thèse concerne l’effet de l’âge sur la réponse comportementale et cérébrale des souris face à un stimulus de looming, mimant l’approche rapide d’un prédateur volant. Des comportements défensifs adaptés sont essentiels à la survie des espèces. Alors que ces comportements commencent à se développer tôt dans la vie d’un individu, les connaissances sur la façon dont ils évoluent chez les individus plus âgés sont encore peu nombreuses. Considérant que le vieillissement s’accompagne d’un déclin des fonctions cognitives et physiques, nous émettons l’hypothèse que les comportements de peur innée et les mécanismes cérébraux sous-jacents pourraient subir des modifications avec l’âge. Ce travail examine donc cette hypothèse en observant la réaction des souris âgées à un stimulus visuel menaçant, comparativement à des souris jeunes adultes. Nos résultats montrent que les souris âgées manifestent une réponse de peur différente de celle des souris jeunes lorsqu’elles sont confrontées au stimulus de looming. Contrairement aux souris jeunes, les souris âgées ont tendance à adopter un comportement de freezing, sans chercher à fuir vers un abri. Il est intéressant de noter que cette réponse comportementale altérée chez les souris âgées est liée à un profil de connectivité fonctionnelle cérébrale distinct de celui des jeunes souris, avec un déficit d’activation cellulaire dans certaines structures cérébrales clés qui régulent les comportements de peur innée.